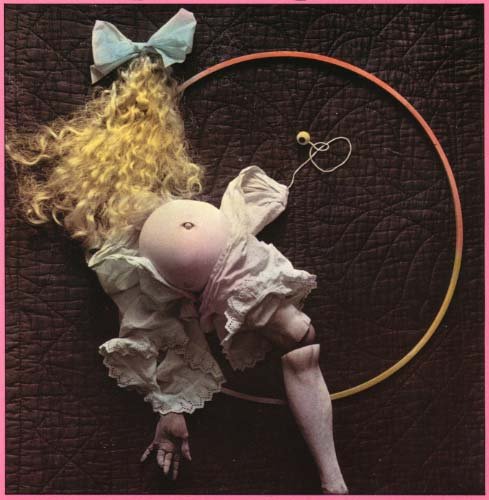L’origine du mal, ainsi pourrait être l’ultime
questionnement de ce film, « Pieta ». L’origine du mal proviendrait elle tout
comme celle du monde, du déliement de l'être à sa mère ?
Notre protagoniste, taciturne et mystérieux, semble n’avoir
de lien, plus de lien aucun, si ce n’est pas n’avoir jamais eu de lien, en tout
cas avoir l’air d’en souhaiter jamais plus aucun. Il vit seul, mange seul, dort
seul, baise seul. Il est seul. Travaille pour le compte d’une obscure banque de
prêt, pour des chefs qu’il ne rencontre jamais. Le seul lien qui le maintient
en communauté est l’argent, matière d’échange par excellence, devenue seul
échange solvable dans l’actuelle société capitalisée. Echange qui lui sert
paradoxalement à désunir les gens, les couples, les familles, les amants. A
amputer les membres, les mains, celles qui permettent de toucher, de donner,
d’affectionner, de lier. Prêt que nombres de petits artisans ne pourront jamais
rembourser. Solution toute trouver : les avilir, les handicaper, les condamner
à une pension à vie, au crochet de la société, comme des poids qu’on ne serait
délier nous forçant à sombrer. Rompre des liens gratuits pour en créer des
obligés. Les compagnons des meurtris, obligés de l’ombre, s’occupent alors de
ces handicapés à vie. Peut-être est ce la peur de cette liaison volontaire et
fragile potentiellement temporaire? Peut-être est ce le souhait qu'elle
devienne à jamais solide et durable, inébranlable moralement et redevable
éternellement ? Pourquoi sinon provoquer un tel mal ?
Parce que lui n’a jamais eu de lien aucun ? Parce que sa
mère est partie, s’est autorisée à briser ce lien inné et sacré, parce que
justement il était fragile et gratuit, qu’elle le pouvait ? La question est
alors de comprendre comment peut il supporter de briser des vies, un si grand
nombre de vies, de projets, et d’amour. Amour asservi et assigné par
l’handicap, quand la pitié et la compassion remplace l’amour profond et
gratuit. La compassion, quel être humain peut il à ce point en être dénué ?
Parce qu’il n’a jamais connu, ressenti, vécu le lien si fort qui nous unit à
une personne que l’on chérie ? Parce qu’il ne sait pas ce que cela fait d’être
"délié" d’une personne aimée ? Comment en effet pourrait il ressentir
ou même appréhender la puissante compassion qu'engendre le regard de ces
désunions lui qui n'en a jamais expérimenté aucune? Expérience sensible qu’il
n’a jamais eu : il ne sait pas ; et n’est pas même en mesure de le savoir.
Alors il exécute sans retenue, un mal qui pour lui n’en est pas un, qui n’a
nulle autre signification que l’obtention d’un dû.
Jusqu’au jour où sa mère entre dans sa vie. Et la fragilité
de ce lien tenu qui le tient. Une claque. Le fouet de la prise de conscience en
plein visage. L’expérience est faite en une fraction de seconde. Avec elle,
l’instabilité d’un lien qu’il faut entretenir, qu’il faut protéger de tous les
dangers; et la terrible conscience de tous ceux qu’il a ainsi brisés. Le
repentir qui ronge un homme envers et contre tout, malgré lui.
L’immense pitié qui nous envahit face à la déchéance de la
conscience humaine, comment peut il seulement le supporter, comment peut-il
seulement continuer à vivre ? Aurait il seulement fallu qu’il en retrouve la
conscience ? Nous spectateurs finissons par le prendre en pitié, pitié
supérieure à toutes celles des familles meurtries, qu’il a brisées. Est ce sa
faute à lui s’il n’a jamais eu de mère? Et si l'on va plus loin, est sa faute à
cette mère? Quelles était la motivation profonde de cet abandon? Peut-être l'a
elle fait car il lui était un souvenir douloureux, souvenir d’un viol d’un
inceste d’un meurtre ? Mais ce meurtre, quel en serait la raison? Et ce mal,
inhérent à la société, d’où proviendrait il ? Quelle en serait son origine?
Comme un état nécessaire à la survie des autres psychiquement stables ? Une
condition sine qua non à l’existence d’une vie en société ? Société alors
gangrenée par un mal qu’elle aurait elle même engendré, des profondeurs de
l’humanité ? Le cancer de notre société?
Et qui est choisi pour en subir les conséquence ? Comment en
vouloir volontairement à quelqu’un qui n’est pas bien né ? Tri arbitraire. Tout
dépend de notre aléatoire nécessaire injuste naissance, déterminant
inconditionnel de notre devenir humain. Et la conscience, instrument de torture
de toutes les impuissants qui savent et comprennent, et n’y peuvent rien.
Film parsemé de petits animaux que l’on torture avec une
allégresse stupéfiante, comme la mise en lumière de ce mal qui ronge la
société, qui suppure de tous ses pores. Cette violence gratuite n’était pas
celle là même à plus grande échelle qu’on serait capable de faire subir à ses
semblables ? Quand la limite est elle franchie ? Y a t il seulement une limite
à ne pas franchir ? La violence gratuite n’est elle pas condamnable quel qu’en
soit l’être vivant? Pourrait on penser, quel autre mal inhérent au vivant que
la sélection naturel ? Le plus faible au profit du plus fort, la lutte pour la
survie interdisant toute faiblesse. C’est bien mal interpréter l’œuvre de
Darwin que de lui en joindre cette théorie. Ce n’est pas le plus fort mais le
plus adaptatif qui survie, le plus à même de s’adapter à des interconnections
sans cessent en évolution. Ce serait oublier bons nombres d’entres-aides et
d’associations au sein de la nature, connections-liens nécessaires entre tous
les êtres vivants de la planète terre. Ou bien, le mal comme unique réponse à
l’incapacité adaptative ? Unique recours pour survivre ? Ultime chance ? Chance
bien miséreuse pour l’homme qui en saisit tout le sens.