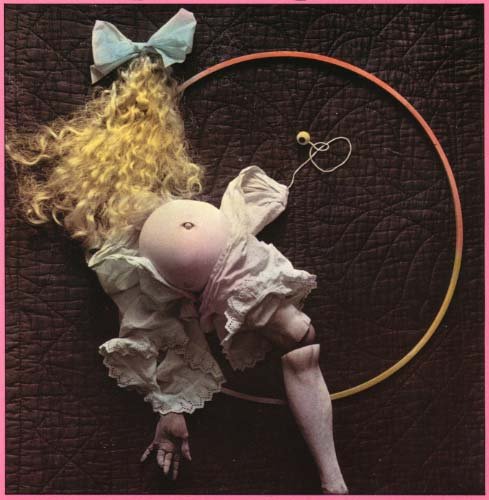La part sombre de l’âme est un thème
qui obsède Werner Herzog. Avec Into the Abyss, il photographie sans filtre
l’Amérique dont on ne parle pas. Cette small-town America trop éloignée des
côtes pour être assise sur les chaises de L.A. la décontractée ou de New York
l’intello branchée. Cette Amérique-là occupe le vaste centre, des milliers de
kilomètres carrés de lisières, triste plaine du milieu qui entend parler de
crise depuis cinq ans alors qu'elle y est à l'état naturel depuis toujours «En
surface, c’est une mer d’huile, il ne se passe rien, explique-t-il. Et sous la
ligne de flottaison, tout n’est que cruauté, violence et catastrophes.». Cependant
croire que l’on a une emprise sur la violence d’une société parce que l’on peut
tuer celui qui a tué s’assimile alors à croire que l’on maîtrise la nature
parce que l’on sait l’ordonner au sein d’une surface circonscrite. Des
illusions de contrôle qui ne servent qu’à s’aveugler plus profondément. Into
the Abyss est finalement bien autre chose qu’un énième film contre la peine de
mort. Il ne s’agit pas ici de faire des criminels des victimes, de minimiser la
violence de leurs crimes ou de mettre en doute la validité du système
judiciaire américain. L’étrange mécanique de Herzog opère à la fois à un niveau
plus pragmatique – l’exécution est une pratique foncièrement stérile – et à un
niveau plus existentiel, érigeant le meurtre étatique en summum de l’absurde.
Une question se pose alors: Le meurtrier est il vraiment fautif
de son propre meurtre ? N’a t il pas eu de mauvaise raisons d’agir de la
sorte ? A t il seulement eu conscience des conséquences de ses
actes ? A t il agit d’une si futile manière (tuer pour une voiture) par simple
envie matérielle? Cela ne provient il pas d’un mal plus profond ? N’est ce
pas la symbolique qu’incarnait cette voiture qui en était le réel motif, une
envie de considération, de considération sociétale dont les caractéristiques mêmes sont
projetées, inconsciemment dans les objets détenus par ceux qui les possèdent,
par ceux ou celles qui en sont dépourvues ? Parce qu’on n’a eu la chance
de naître au bon endroit dans la bonne famille avec les bonnes composentes et les
bons moyens de réussir ? Comment se fait il qu’au final, ce soit dans la
matérialité des objets que de telles valeurs soient véhiculées ? N’est ce
pas notre société et le capitalisme qu’elle héberge et cautionne le véritable responsable
du passage à l’acte ?
Ce n’est pas la faute du meurtrier, non, mais de la société, de la société qui fabrique ses propres meurtriers,
véritables objets de la société et du capitalisme. La société, mais qui en sont
ces acteurs ? Nous, le quidam, tout un chacun ? Serions nous alors
tous responsables, de tous les meurtres qui sont commis en son sein ? La
société responsable de son propre mal, se retournant contre elle même, telle
une maladie auto immune, qui la gangrène, une putréfaction de l’intérieur. Je
suis donc responsable et c’est un vide abyssale. Into the abyss, dans les
abysses de la société, au sein même des intraveineuses irriguant la tumeur qui
l’affaiblit, l’inextricable petit amas de cellules dont la croissance ne peut être
contrôlée, proliférant sans rien ni aucun moyen qui ne puisse en venir à
bout : étant de fait, conséquence ultime à l’existence même d’une société
en bonne santé : une poignée doit être sacrifiée pour la bonne santé de la
majorité. On ferme les yeux, ce serait trop dure à porter, le poids d’une telle
responsabilité sur sa conscience, bonne situation acquis par le sacrifice d’une
minorité. N’y a t il vraiment aucun moyen d’exister sainement sans mettre une
partie de côté ? A ne plus rien comprendre, face à cette impuissance,
comme un mal inhérent à la vie en société. Quel gâchis ! Quelle
injustice ! Encore faudrait il qu’on le mérite vraiment ! C’est à ça
que la politique devrait réfléchir, comme soigner un mal si profondément encré
dans la société, qu’elle porte en elle depuis des millénaires, des générations
entières d’hommes et de femmes, un poids qui finira par la ronger toute
entière, plus seulement au cas par cas ou par épisodes belliqueux mais dans sa
globalité, par l’effondrer.
Reste à chacun de se demander :
Et comment vas tu vivre ton tiret du milieu ?